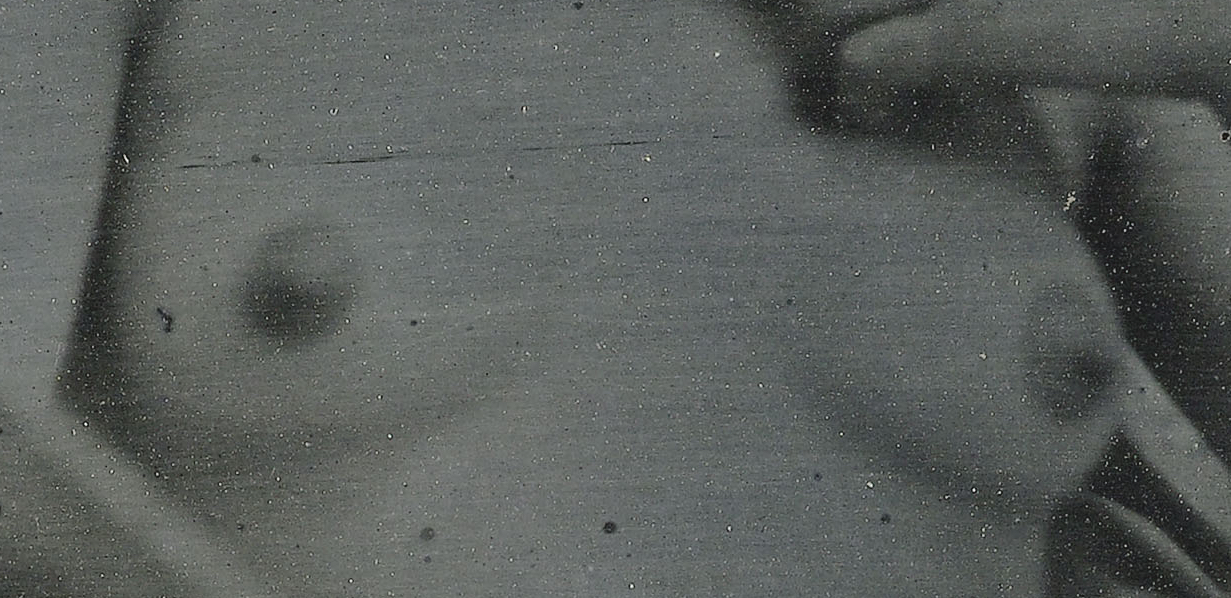Commençons gentiment. Un cliché de Riesener. Je gage que c’est une fille de la campagne, enfin, quelqu’une qui passe beaucoup de temps dehors, car son visage et sa main gauche sont plus sombres que sur le reste du corps, ce qui indique donc un bronzage, qui, bien avant qu’il ne fut à la mode, signifiait une classe sociale inférieure (paysan, marin, soldat, etc.), à laquelle il ne fallait surtout pas ressembler, à commencer par l’épiderme, qui se devait d’être blanc immaculté. On ne la sent pas très à l’aise, cette jeune femme, malgré son expressions butée.


Ici, chez Braquehais (remarquable photographe de la Commune de Paris), la pose a vraiment quelque chose d’emprunté : qui se tiendrait comme ça ? Il est curieux de voir à quel point les photos de nus sont caractérisées par une certaine niaiserie, comme encore ici :

Encore une fois, qui se tient comme ça ? C’est ridicule. Cet article ne se veut bien entendu pas exhaustif, mais, en cherchant, il me semble que Moulin est encore celui qui s’en tire avec le plus de grâce :

Elle est bien jolie, cette Céline, mais il est dommage qu’elle soit embarrassée de ce tas informe de toile, dont on se demande bien la fonction.

Ci-dessus un autre exemple, chez Moulin, d’une délicatesse non niaise. On peut noter cette curieuse tendance à coloriser ce qui au départ n’était que noir et blanc. Cela donne un aspect un peu étrange, sur lequel je ne m’attarde pas pour le moment, mais cela mériterait d’y réfléchir.
La photographie n’a pas ignoré l’érotisme ou ce qu’on appelle, à défaut d’autre chose, pornographie, quand on pourrait aussi, après tout, parler, par exemple, de “scènes de nature”. Auguste Belloc, qui était un pionnier en la matière, ayant écrit plusieurs ouvrages scientifiques sur le sujet, était aussi un grand amateur de chair. Sylvie Aubenas et Philippe Comar nous apprennent qu’en octobre 1860, la police est venue à son domicile pour saisir 5000 clichés “licencieux”. Curieusement, six ans plus tard, on prend soin d’en déposer certains à la Bibliothèque Impériale, mais il n’en reste que 195… Où sont donc passés les autres ? Certainement que quelques mains officielles les auront gardées par devers elles, afin d’en profiter en toute intimité. Mais aujourd’hui, bien rangées dans l’Enfer de la Bibliothèque Nationale, ne demeurent que 24 vues stéréoscopiques.
Belloc a pris beaucoup de clichés parfaitement niais, des nus aussi empruntés que ceux de ses collègues, mais il a “su” aussi montrer crûment le sexe, comme ici :

Bien sûr, en voyant ce cliché, on ne peut guère éviter de penser à la fameuse “Origine du monde” (1866) de Gustave Courbet. Mais si Courbet se sera inspiré du cliché, car nous savons qu’il l’a vu, et qu’il admirait son ami Belloc, le tableau n’en est pas une copie à la peinture. On peut remarquer cependant un détail (si l’on peut dire) propre aux deux représentations : la vulve est rougie ; coloriée sur photo, ainsi que sur le tableau. Pourquoi Belloc a-t-il donc éprouvé le besoin de rougir la vulve ? C’est une question à laquelle n’a jamais répondu Martin Heidegger. Il serait temps de s’y pencher. On lit ici et là que les deux cadrages sont identiques. Eh bien ! non. Belloc “prend” en surplomb, tandis que Courbet semble presque à hauteur du corps, comme dans la fameuse gravure de Dürer. Et puis, franchement, je crois qu’entre la photographie de Belloc et le tableau de Courbet, on sait où se trouve le pornographe. La photographie, quand bien même semblant sur le vif, est aussi empruntée ; car on sait, par un autre cliché, que la jeune femme tient dans sa main jupon et jupe remontés, et donc elle tient la pose. En sus, elle est assise, tandis que, chez Courbet, Constance Quéniaux — 34 ans —, semble allongée, ravie, du moins abandonnée au plaisir qui vient probablement d’avoir lieu. Il y a donc du temps, ici, et il n’y en a pas chez Belloc, car si la femme chez Courbet peut rester longtemps abandonnée, le modèle de Belloc ne peut pas rester 107 ans ainsi. La pose en photographie est donc empruntée et rehaussée de vulgarité par le coloriage des labia, tandis que l’on peut supposer que la vulve de Constance n’est rougie que depuis l’amour qu’elle vient de faire avec… ou pas ; c’est peut-être purement fictionnel, car nous savons que Mlle Quéniaux était l’une des maîtresses d’un diplomate turco-égyptien, Khalil-Bey, menant grand train à Paris, et qui avait commandé ce tableau à Courbet, et l’on peut donc supposer sans risque de se tromper que le diplomate avait aussi eu connaissance des photographies de Belloc, et en conclure alors que ce n’est pas Courbet qui a choisi ce type de cadrage, c’est son commanditaire. Ce dernier l’avait serré dans son cabinet de toilette, et lui avait ajouté en parement un voile vert, qu’il suffisait d’écarter pour voir le tableau. Il est curieux de constater que même le commanditaire avait eu soin de cacher ce sexe à la vue de tous, à commencer par la sienne ; il pouvait ne pas la voir. Comment faut-il prendre cette précaution ? Comme une pudeur ? La peur que quelqu’un tombe dessus par inadvertance ? Cette pudeur semble avoir été contagieuse, car on sait que le dernier propriétaire du tableau, Jacques Lacan himself, avait demandé à André Masson un dispositif afin d’insérer le tableau dans un cadre coulissant, si bien que, là encore, personne, entré chez Lacan, ne pouvait voir de quoi il retournait ; il fallait faire coulisser le tableau de Masson pour voir apparaître, en dessous, celui de Courbet. C’est assez incroyable que même Lacan eut éprouvé cette gêne scopique, et il y aurait certainement à dire sur ces scrupules. Une fois Lacan décédé (1981) ainsi que sa femme, Sylvia Bataille-Lacan (1993), le Ministère de l’Économie et des Finances accepta, en 1995, la dation de l’œuvre au Musée d’Orsay. En attendant, le public new-yorkais aura pu apprécier la peinture en 1988, lors de l’exposition Courbet Reconsidered ; et, avant de s’installer à Paris, elle aura été exposée à Ornans en 1992.


Nous sommes habitués, dans nos sociétés pornographiques lato sensu, à voir des sexes (et nous en voyions bien avant l’arrivée de l’Internet, et par exemple dans les kiosques à journaux. Il suffisait de lever les yeux, et personne ne se plaignait de cette vulgarité. Ça devait être considéré comme “normal”.) Du coup, peut-on imaginer l’extraordinaire effet qu’a dû produire ce tableau, qui semble grandeur nature, comme on peut le constater en comparant avec les deux agents ? Malgré ce cadre kitsch et lourd, pléonastique (un cadre dans le cadre) cela reste saisissant.
Léon Mychkine
Newsletter
Art-icle n’est pas subventionné, ni monétisé. Et pourtant, il connaît plus de 4000 lecteurs/mois. Vous pouvez contribuer à son épanouissement en opérant un virement ici, ce dont je vous remercie par avance.